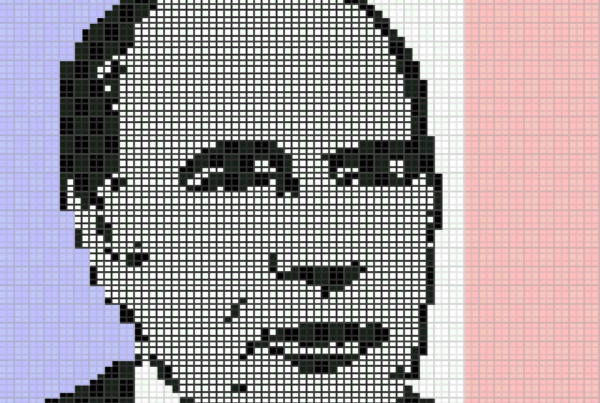Depuis plusieurs années déjà, Emmanuel Macron creuse le sillon de la repentance au sujet de la guerre d’Algérie et de la présence française outre-Méditerranée. Entamée avec l’accusation de « crime contre l’humanité » portée contre notre pays en 2017, cette stratégie s’est poursuivie par de multiples gestes symboliques à sens unique, jusqu’à la remise en janvier dernier du rapport Stora sur la « réconciliation mémorielle » – cette dernière étant visiblement conçue à la charge exclusive du peuple français.
Quoique fondamentalement déséquilibrée et animée par une haine de soi typique des élites en place, cette démarche revendique un objectif que d’aucuns pourraient juger louable : tourner définitivement la page historique de ce conflit sanglant et de la décolonisation.
Dans cette perspective, plutôt que d’accabler la France sous un tombereau de griefs souvent fantasmés, le courage politique commanderait d’oser en finir avec l’un des legs les plus concrets et les plus encombrants de la période concernée : le statut dérogatoire accordé aux Algériens en ce qui concerne leur immigration sur notre territoire.
Ce traitement particulier résulte de l’accord franco-algérien (AFA) du 27 décembre 1968 « relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ». La signature de l’AFA s’inscrivait dans la continuité des accords d’Evian du 19 mars 1962, lesquels prévoyaient initialement une liberté totale de circulation et d’installation entre l’Algérie et la France[1].
Si l’accord franco-algérien et ses avenants successifs de 1985, 1994 et 2001 n’ont pas repris ce principe de libre-circulation, ils ont néanmoins validé et ancré l’existence d’un régime favorable exorbitant du droit commun pour les immigrés algériens. L’AFA continue aujourd’hui de fixer de manière exclusive leurs conditions de séjour, auxquelles les règles ordinaires du CESEDA – le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile – ne sont aucunement applicables.
Par rapport aux autres étrangers non-européens, les Algériens bénéficient ainsi d’un nombre certain de privilèges quant à leur installation dans notre pays – qui sont de trois natures principales :
- Leur admission au séjour pour motifs familiaux est facilitée : les Algériens n’ont pas à justifier d’une vie commune en France avec leur conjoint depuis 6 mois au moins pour obtenir une première carte « conjoint de Français »[2].
- Leur admission au séjour pour motifs « professionnels » est également plus aisée : ils disposent d’une complète liberté d’établissementen tant que commerçants ou professions indépendantes, ce qui leur permet d’obtenir un titre de séjour associé. Il leur suffit pour cela de s’immatriculer auprès du registre professionnel concerné, sans jamais devoir démontrer la viabilité économique de leur projet[3].
- Enfin, les Algériens peuvent demander plus vite une carte de séjour de 10 ans : après seulement 3 ans de séjour[4] contre 5 ans dans le droit commun. Lorsqu’il s’agit du conjoint algérien d’un citoyen français[5] ou du parent algérien d’un enfant de nationalité française[6], l’exigence est même abaissée à 1 an de séjour.
En plus de leur « générosité » intrinsèque, de telles dispositions offrent évidemment des opportunités élargies aux fraudeurs – qui s’en donnent à cœur joie. A ces principaux avantages s’en ajoutent encore d’autres, dont la prise en charge par les contribuables français du coût de l’émission des « certificats de résidence »[7] (nom des titres de séjour spéciaux réservés aux Algériens) – là où les étrangers non-européens sont normalement redevables d’une somme de 225 euros.
Les Algériens constituent aujourd’hui la première communauté immigrée dans notre pays, avec 846 000 « immigrés » au sens strict – individus nés étrangers à l’étranger – en 2019 selon les données de l’INSEE[8]. Il faut y ajouter environ 1,1 million de personnes nées en France d’au moins un parent immigré algérien (toujours d’après l’INSEE)[9], qui conservent bien souvent la nationalité algérienne – avec ou sans binationalité française. Sans même tenir compte de la « troisième génération » dont l’assimilation n’est hélas pas toujours effective, ni des clandestins présents sur le territoire national, toute tentative d’estimation aboutit donc à 2 millions de personnes a minima. Le président algérien en revendiquait 6 millions dans un entretien télévisé à l’été 2020[10].
Sans méconnaître les trajectoires individuelles de réussite, cette population nombreuse concentre d’importantes difficultés d’intégration. Les données objectives ne manquent pas lorsqu’il s’agit d’étayer ce diagnostic. Pour n’en citer que trois exemples :
- 41,7 % des Algériens vivant en France en 2016 étaient chômeurs ou inactifs, soit un taux trois fois plus élevé que celui des Français (14,2%) d’après le Ministère de l’Intérieur[11];
- 50% des ménages immigrés algériens vivaient en HLM en 2017, soit un taux trois fois supérieur à celui des ménages non-immigrés (13%) d’après le Ministère de l’Intérieur[12];
- Les Algériens constituaient la nationalité étrangère la plus représentée dans les prisons françaises en 2018, d’après le Ministère de la Justice[13].
Ces constats sont d’autant plus marquants que tout porte à redouter une forte vague migratoire venue d’Algérie dans les prochaines années – entre le nouveau « baby-boom » que connaît ce pays (22% de sa population avait moins de 10 ans en 2018 ; 37% avait moins de 20 ans[14]) et l’apathie complète de son économie, dépendante du pétrole saharien dont les réserves s’amenuisent et dont les cours mondiaux sont en baisse constante. Par facilité politique, le gouvernement algérien pourrait même encourager cette tendance à l’exil, comme le suggère déjà son absence récurrente de coopération dans la reconduite des clandestins à la frontière.
Soixante ans après l’indépendance, il importe désormais de traiter l’Algérie comme ce qu’elle proclame être sur tous les tons : un Etat-nation de plein exercice, intégralement souverain, entièrement responsable de sa population et de son destin. Une telle conviction implique de dénoncer l’accord franco-algérien de 1968 et d’aligner pleinement son régime d’immigration sur le droit commun – lequel doit évidemment faire l’objet de très profondes réformes.